En 2011, La revue internationale de l’éducation familiale publiait un article de Patrizia Romito (professeure de psychologie sociale à l’université de Trieste, Italie) : Les violences conjugales post-séparation et le devenir des femmes et des enfants
La lecture de cet article (retranscrit dans son intégralité ci-dessous) est fondamentale, car il faut impérativement que le gouvernement français intègre des garde-fous contre la violence conjugale dans sa nouvelle loi famille (proposition de loi APIE – autorité parentale et intérêt de l’enfant). Cette proposition de loi doit être examinée à l’Assemblée Nationale dès le 19 mai 2014.
Depuis 2002, l’association SOS Papa a réussi à faire exclure les violences conjugales de la loi famille, sous prétexte qu’« un mari violent peut être un bon père ». Or, selon Patrizia Romito (voir article ci-dessous) « entre 40 et 60% des maris violents sont aussi des pères violents (Edleson, 1999 ; Unicef, 2003) ». Donc cette affirmation de SOS Papa est d’une dangerosité extrême pour les enfants et leur mère. Mais n’ayant consulté quasiment que les associations de pères et non les spécialistes, les députés de l’époque n’ont pas été choqués de cela. La loi de 2002 a d’ailleurs été surnommée « loi SOS Papa », parce qu’elle reprenait quasiment toutes les demandes de SOS Papa, ignorant les avis des spécialistes de la violence conjugale et des médecins (psychiatres, pédopsychiatres, etc.) qui demandaient pourtant à être entendus.
A cause de la « loi SOS Papa », depuis 2002, les mères et les enfants confrontés à des hommes violents vivent des situations dramatiques. Après la séparation, ces hommes violents continuent d’exercer en permanence leur violence, allant parfois jusqu’au meurtre ou l’assassinat des enfants et/ou de leur mère pour se venger de la mère qui a osé les quitter.
Donc la loi famille de 2014 doit absolument prendre en compte les violences conjugales qui s’amplifient fréquemment après la séparation. En 2014, comme en 2002, c’est encore majoritairement les associations de pères qui sont entendues par le gouvernement. Malgré leur demande, les médecins (psychiatres, pédopsychiatres, etc.) n’ont pas été entendus (comme en 2002). Comment est-ce possible pour une loi qui prétend s’occuper de l’intérêt de l’enfant, donc de sa santé ? Pour les députés, l’intérêt de l’enfant est-il véritablement sa santé ? Ou est-ce l’intérêt des pères dont il est question dans cette loi, comme dans celle de 2002.
Patrizia Romito est l’auteure de
Un silence de mortes : La violence masculine occultée
(lien ci-dessus: article de Sisyphe, avec extrait de l’introduction d’Un silence de mortes – La violence masculine occultée, de Patrizia Romito, Ed. Syllepse, Paris, 2006, pp. 15-25)
A propos du danger de la séparation dans un contexte de violence conjugale, 6 mères survivantes du meurtre de leurs enfants par leur ex-conjoint ont adressé un manifeste au gouvernement du Québec, afin de développer des mesures pour prévenir et accompagner les mères confrontées à ce type de situation : Manifeste des mères survivantes au meurtre de leur(s) enfant(s) par leur ex-conjoint et père biologique
L’article de Patrizia Romito
Les violences conjugales post-séparation et le devenir des femmes et des enfants (La revue internationale de l’éducation familiale, n°29, 2011, p. 87-106)
« L’article présente une analyse des connaissances sur le thème des violences conjugales après une séparation ou un divorce et de l’impact de ces violences sur la vie des femmes et des enfants. L’argumentation s’appuie sur une base de données internationale très riche qui montre la fréquence et la gravité de ces violences. Des recherches menées dans différents pays montrent aussi que ces violences restent peu visibles et que cette invisibilité est un obstacle majeur dans la protection des femmes et des enfants. Le texte analyse différents mécanismes d’occultation, comme le mythe des « fausses dénonciations » et discute de leur impact sur la perception sociale des violences conjugales post-séparation et sur la vie des victimes.
Mots-clés : violences conjugales, séparation, garde des enfants, inceste, fausses dénonciations
Introduction
La première étude que j’ai conduite en 1995 sur les violences envers les femmes consistait en une série d’interviews de femmes victimes de violences conjugales ainsi que de médecins, psychologues et assistant-e-s sociales qui, par leur profession, avaient l’occasion de rencontrer des femmes maltraitées. Ce qui m’avait le plus frappée était la question qu’un certain nombre des professionnels posaient d’un air souvent excédé :
« Mais pourquoi ne le quitte-t-elle pas ?». Cette question non seulement renversait la responsabilité de la situation sur la victime mais révélait aussi une grande méconnaissance des mécanismes des violences conjugales. En fait, les femmes interviewées dans la même étude et qui avaient quitté avec beaucoup de difficultés un partenaire violent relataient toutes des violences, souvent très graves, dont elles avaient été victimes après la séparation (Romito, 1996, 2001). De plus, au cours des mêmes années, une analyse des cas de meurtres parmi des partenaires intimes en Italie montrait que dans la plupart des cas il s’agissait de femmes tuées par des ex-conjoints, maris, concubins ou « fiancés » durant ou après une séparation (Quaglia, 2005). Donc les violences conjugales post-séparation existaient vraiment et représentaient, alors comme maintenant, une des raisons pour lesquelles une femme maltraitée hésite à se séparer du conjoint violent, mais elles semblaient à l’époque être peu visibles, du moins chez les professionnel-le-s censés intervenir auprès des femmes.
Ces violences sont-elles aujourd’hui plus visibles, plus reconnues en tant que telles ? On en entend beaucoup parler autour des conflits pour la garde des enfants ou des droits de visite après la séparation du couple parental mais souvent, comme nous le verrons par la suite, pour accuser les femmes de les inventer. Donc on évoque ces violences, mais plutôt pour les nier. On les mentionne, surtout au niveau médiatique, quand un homme tue son ex-femme et parfois ses enfants. Dans ces cas, la violence est évidente, indiscutable. Mais le meurtre n’est que très rarement présenté comme la suite des violences qui avaient eu lieu pendant la vie commune. Au contraire, il est présenté comme un phénomène totalement différent, séparé de la violence conjugale et dû à un surcroît de « passion » ou de douleur, au point que l’homme violent est parfois dépeint comme la véritable victime (Houel, Mercader, & Sobota, 2003 ; Romito, 2006).
Dans cet article, je montrerai que les violences conjugales post-séparation restent peu visibles et mal comprises aujourd’hui encore et que cela peut avoir des conséquences très graves pour les personnes impliquées. Je le ferai à l’aide d’un ensemble, désormais riche, de recherches conduites dans différents pays. En fait, malgré les différences d’histoire, de culture, de lois et de pratiques sociales de ces pays, les tendances relevées sont très semblables, ce qui rend possible l’utilisation de ces données variées pour une meilleure compréhension du phénomène.
Fréquence des violences conjugales post-séparation
De nombreuses recherches montrent qu’après une séparation ou durant la période qui l’entoure, les femmes courent un risque de violences conjugales très élevé. D’après l’enquête nationale Enveff, en France (Jaspard et al., 2003), parmi les femmes ayant eu par le passé au moins une relation de couple et qui ont été en contact avec leur ex-conjoint au cours des douze derniers mois, 16,7% ont subi des violences physiques ou sexuelles de sa part et ceci malgré le fait que dans la plupart des cas ces relations aient été épisodiques. De plus, dans le sous-groupe de femmes qui avaient eu des enfants avec cet ex-conjoint, neuf sur dix avaient subi des agressions verbales – insultes et menaces – ou physiques (Jaspard et al., 2003). Selon les données nationales canadiennes (Hotton, 2001), parmi les femmes qui, dans les cinq ans précédant la recherche, avaient été en contact avec un ex-conjoint, 39% avaient été agressées par lui. Il s’agissait souvent de violences graves : un tiers des femmes agressées avait risqué d’être étranglé ; plus d’un tiers avait subi des viols ou des tentatives de viol. En outre, dans la moitié des cas, ces violences avaient eu lieu très fréquemment (plus de 10 fois) ; dans plus de la moitié des cas, les femmes avaient subi des blessures et avaient eu peur d’être tuées. Les abus psychologiques – insultes, comportements de contrôle, destruction d’objets et agressions ou menaces à des proches – touchaient presque toutes ces femmes. Quand les femmes avaient des enfants, ces derniers avaient assisté aux violences dans presque deux tiers des cas (72,4%), souvent à l’occasion de violences si graves que leur mère avait craint d’être tuée (Hotton, 2001).
Il n’est pas aisé, à partir des données disponibles, de savoir dans quelle mesure les violences après la séparation sont la continuation des violences précédentes ou bien si elles sont déclenchées par le stress lié à la séparation. Considérons les femmes qui, au Canada, subissent des violences conjugales après la séparation : pour 61% d’entre elles il s’agit de la continuation (37%) ou de l’aggravation (24%) des violences précédentes ; dans 39% des cas, ces violences ont commencé après la séparation (Hotton, 2001). L’enquête nationale menée en Grande-Bretagne prend en considération les femmes qui avaient subi des violences conjugales pendant la vie commune : pour 37% d’entre elles, la violence continue après la séparation et, pour quelques-unes, les violences les plus graves sont arrivées précisément après la séparation (Walby & Allen, 2004)1. Après une analyse de ces recherches, Brownridge (2006) conclut que, comparée à une femme mariée, une femme séparée a une probabilité de subir des violences conjugales 30 fois plus élevée et une femme divorcée 9 fois plus élevée.
Les enfants dans les violences post-séparation
D’après les résultats de nombreuses études, entre 40 et 60% des maris violents sont aussi des pères violents (Edleson, 1999 ; Unicef, 2003)2 ; l’un des principaux facteurs de risque d’agressions sexuelles de la part du père est la violence conjugale contre la mère (Fleming, Mullen, & Bammer, 1997 ; Humphreys, Houghton, & Ellis, 2008). Dans une étude faite en Italie, sur un échantillon de 773 adolescentes et adolescents, quand le père inflige des violences physiques à la mère, dans 44% des cas il est aussi physiquement violent envers les enfants et, dans 62% des cas, il est psychologiquement violent : il insulte, dénigre et menace (Paci, Beltramini, & Romito, 2010). Les violences post-séparation visent donc aussi les enfants, non seulement comme « témoins » des agressions envers leur mère, mais aussi directement. En Grande-Bretagne, Radford, Hester, Humphries et Woodfield (1997) ont observé pendant plusieurs années 53 femmes séparées d’un mari violent : 50 d’entre elles ont été agressées à répétition au cours des rencontres avec leur ex-partenaire pour « échanger » les enfants et la moitié de ces enfants ont subi des violences physiques ou des abus sexuels du père pendant les visites. Dans une étude en Australie, 40 femmes qui négociaient les arrangements de « child contact » avec un ex-partenaire violent ont été interrogées : dans 25 cas, les enfants avaient assisté aux violences du père envers la mère et, dans 13 cas, ils avaient été maltraités physiquement par lui (Kaye, Stubbs, & Tolmie 2003 ; voir Flood, 2010). Ces résultats sont confirmés par de nombreuses études réalisées dans différents pays (Eriksson, Hester, Keskinen, & Pringle, 2005 ; Radford & Hester, 2006 ; Radford, Sayer, & Amica, 1999).
Dans plusieurs pays, des centres de contact ou de visites ont été créés pour essayer de résoudre ces problèmes, du moins en partie. Dans les cas d’un conjoint violent qui n’aurait pas la garde des enfants – presque toujours le père – les visites entre père et enfant sont organisées dans un endroit neutre – une école, un centre de quartier – parfois sous la supervision d’un éducateur ou d’un travailleur social qui doit vérifier que le père ne profite pas des rencontres pour agresser physiquement ou verbalement son ex-conjointe ou les enfants. Toutefois, l’instauration d’un tel système pose de nombreuses difficultés. D’abord, ces services coûtent cher et dans la plupart des pays ils ne sont pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins ; et puis, souvent les travailleurs préposés n’ont pas les moyens pour surveiller ces hommes et les empêcher de nuire (Eriksson, Hester, Keskinen, & Pringle, 2005 ; Furniss, 1998 ; Harrison, 2008).
1 Les contradictions entre les données provenant de différentes recherches sont dues en partie aux différences dans la méthode et, en partie, aux différences réelles parmi les échantillons de femmes concernées.
2 Certains auteurs incluent aussi dans les violences du père celles envers la conjointe enceinte qui peuvent entraîner des pathologies de la grossesse, des avortements et une moins bonne santé du bébé à la naissance (Sarkar, 2008).
La violence létale : les meurtres des femmes et des enfants
Partout dans le monde, la très grande majorité de victimes d’homicide parmi des « partenaires intimes » sont des femmes ; une autre différence de genre est que, dans la plupart des cas, les hommes tuent après avoir infligé pendant des années des violences conjugales alors que les femmes tuent après les avoir subies (Campbell et al., 2003). Une analyse des données statistiques relatives à ces homicides en Amérique du Nord montre que les femmes séparées courent un risque cinq fois plus élevé d’être tuées que les autres femmes : en termes épidémiologiques, la séparation est donc un puissant facteur de risque de fémicide (Brownridge, 2006). En Italie, nous ne disposons pas de données nationales fiables à ce propos ; mais, d’après une étude de la presse, 18 femmes ont été tuées par un homme pendant le mois de juillet 2010, un mois particulièrement sanglant : dans 16 cas sur 18, le meurtre a eu lieu après une séparation voulue par la femme et refusée par l’homme. Les victimes étaient dans la majorité des cas les ex-conjointes, mais aussi leurs enfants, leur mère ou leur sœur.
Comme pour les autres formes de violence post-séparation, les enfants peuvent également être visés par les meurtres. En Grande-Bretagne, une étude a analysé les cas de 29 enfants tués par leur père après la séparation du couple parental (Saunders, 2004). Ces homicides avaient eu lieu dans le contexte de négociations très conflictuelles entre les parents pour la garde des enfants ou le droit de visite. Dans presque tous les cas, les mères avaient subi des violences conjugales, parfois gravissimes. Malgré cela, le Tribunal les avait obligées à accepter les contacts entre le père et les enfants.
La nature des violences conjugales après la séparation
Hormis pour les cas d’agressions, relativement rares, qui surgissent exclusivement à la suite d’une séparation et après une vie commune dépourvue de violence, il semble bien que les violences conjugales post-séparation soient de la même nature que les violences conjugales, telles qu’elles ont été décrites et conceptualisées par Pence et Paymar (1993). Il s’agit d’un ensemble de comportements, caractérisé par la volonté de domination et de contrôle d’un partenaire sur l’autre, qui peuvent inclure brutalités physiques et sexuelles, abus psychologiques, menaces, contrôles, grande jalousie, isolement de la femme ainsi que l’utilisation des enfants à ces fins, par exemple, en les contraignant à espionner leur mère ou en menaçant la conjointe de lui enlever les enfants – et même de les tuer – en cas de séparation.
Les motivations à ces violences peuvent être regroupées en trois catégories susceptibles de coexister et se superposer : représailles et vengeances, rétablissement de la situation de pouvoir et de contrôle et tentative de forcer une réconciliation. Les hommes qui pensent que la femme et les enfants leur appartiennent – une conviction que souvent sous-entendent les violences conjugales – voient la séparation comme une trahison et un attentat à leurs droits qui justifient la vengeance et la punition de la femme allant jusqu’au meurtre de celle-ci ou des enfants (Brownridge, 2006). C’est d’ailleurs ce qu’un certain nombre d’entre eux affirment explicitement. Voici des exemples tirés de journaux italiens :
A.M. égorge sa fille de 8 ans et dit le faire comme « punition contre son ex-femme » (janvier 2000). M.G. étrangle ses deux fils (septembre 2002) après avoir écrit à son ex-épouse : « J’espère que toute ta vie sera un cauchemar et que tu vivras assez longtemps pour souffrir de tes remords ». Et R.G. tue ses deux fils à coups de couteau (avril 2004) en hurlant à sa femme : « Je te les ai tués, comme ça tu sauras ce que c’est que de souffrir » (Romito, 2006).
La souffrance de ces hommes est évidente, ainsi que leurs sentiments d’impuissance et l’incapacité de faire face à la séparation. Mais alors que ces sentiments, cette douleur sont mis en exergue par les journalistes, les éléments de possession, contrôle et vengeance ne sont jamais discutés et, à terme, c’est plutôt l’homme qui apparaît comme la véritable victime surtout s’il finit par se suicider (Houel et al., 2003). Dans tous ces articles sont évoqués globalement des « conflits conjugaux », sans la moindre référence explicite à la violence exercée précédemment par ces hommes, violence qui avait provoqué chez leur femme son « abandon » et sa fuite.
Les conflits pour la garde des enfants
Comme nous l’avons vu, la violence post-séparation est très fréquente quand le couple a des enfants. Parfois ces derniers sont directement concernés, d’ailleurs les conflits liés à la garde et les rencontres entre ex-conjoints, rendues nécessaires pour s’« échanger » les enfants, deviennent souvent l’occasion d’autres violences envers les femmes (Radford & Hester, 2006). À la lumière de ces données, il est légitime de se demander comment il se fait que les institutions – surtout les services sociaux et les tribunaux – ne protègent pas mieux les victimes de ces violences.
Pour répondre à cette question, il faut placer ces situations dans leur contexte social et historique. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, dans les pays occidentaux, les enfants étaient la propriété du père et restaient avec lui en cas de divorce. Cette praxis représentait d’ailleurs un solide instrument de dissuasion à l’encontre des femmes qui auraient songé à quitter leur mari, même si celui-ci était violent (Smart & Sevenhuijsen, 1989). À partir de la moitié du 20ème siècle, on voit apparaître la thèse de la « préférence maternelle » (tender years doctrine) selon laquelle les enfants en bas-âge ont besoin de leur mère. Les pratiques concernant la garde parentale après divorce ont donc commencé à se modifier et on confia de plus en plus souvent la garde des enfants aux mères. Jusqu’à très récemment, dans les pays industrialisés où l’on a enregistré une augmentation des divorces, dans la majorité des cas demandés par les femmes, la tendance générale a été de confier les enfants à leur mère après commun accord des deux parents, fréquemment avec un éloignement matériel et psychologique des pères. Cet éloignement soulève de nombreux problèmes, entre autres économiques : lorsque des pères n’ayant pas la garde ne paient pas la pension alimentaire pour leurs enfants, nombre de mères sont obligées de recevoir une aide économique de l’État, avec des coûts importants pour la collectivité. S’ajoutent à cela des préoccupations relatives d’une part aux potentielles conséquences psychologiques pour l’enfant de grandir en l’absence de père, de l’autre sur l’idée que cette absence et la relative autonomie des mères puissent saper les fondements de la famille traditionnelle basée sur l’autorité masculine (Kurki-Suonio, 2000 ; Smart & Sevenhuijsen, 1989). Par ailleurs, dans les années 70, principalement dans les pays de langue anglaise et du nord de l’Europe, apparaît un nouveau discours fondé sur l’égalité entre les sexes et sur l’idée ou le vœu que les parents sont l’un autant que l’autre capables d’élever leurs enfants après le divorce (Eriksson et al., 2005).
Dans ce contexte, la garde conjointe ou alternée des enfants attribuée aux deux parents et le partage des responsabilités après le divorce, selon des formules qui varient d’un pays à l’autre, sont présentés comme le remède permettant que les pères soient plus concernés, tant sur le plan psychologique qu’économique, et assurant le respect du principe de l’égalité entre les genres. Entre 1979 et 1989, l’État de Californie, la Suède, la Finlande et la Grande-Bretagne ont privilégié l’option de la garde conjointe, indépendamment de l’implication réelle du père avant le divorce (Kurki-Suonio, 2000). Depuis, d’autres pays européens, dont la France et l’Italie, ont fait passer des lois semblables. Il faut noter que lorsque l’on parle de garde conjointe, on entend par là une garde légale et non pas une garde matérielle; ceci peut signifier que la mère continue à s’occuper quotidiennement des enfants mais que le père aura le droit d’intervenir et d’interférer dans la vie de tous les jours des enfants et de son ex-femme. Cette ingérence, toujours source potentielle de conflits, peut devenir tragique lorsque la mère se trouve face à un homme dominateur et violent (Brownridge, 2006 ; Radford & Hester, 2006).
Des recherches menées dans différents pays montrent que les cas de conflits pour la garde des enfants sont malgré tout assez rares : il n’y a conflit pour la garde parentale que dans à peine plus de 10 % des divorces, les enfants étant alors confiés au père dans la moitié des cas (Flood, 2010 ; Rhoades, 2002). Dans ces situations, il y a souvent des violences conjugales avant et après la séparation et parfois aussi des violences du père envers les enfants. Mais ces violences sont rarement perpétrées devant témoins : leur existence peut être difficile à démontrer puisque les violences reposent surtout sur les déclarations des femmes et des enfants ou sur les séquelles de santé sur les victimes. Cependant, même lorsqu’il y a des preuves objectives de violences de la part de l’homme (témoignages indépendants, blessures, condamnations), les services sociaux peuvent donner un avis favorable aux contacts entre le père et les enfants et le tribunal peut trancher dans ce sens (Kaspiew, 2005 ; Kaye et al., 2003 ; Radford & Hester, 2006). Comment cela est-il possible ? Les raisons qui fondent ces décisions relèvent d’un mélange d’éléments divers : d’une part, l’on soutient que les enfants souffriraient d’être privés d’une relation avec leur père même s’il est violent ; de l’autre, l’on affirme qu’un père a des droits sur ses enfants et que ces droits doivent être respectés même s’il est violent. Voici, à titre d’exemple, un de ces cas :
À San Francisco, Kevin S. a tué son fils de 8 ans qui avait passé l’après-midi avec lui. Les conjoints étaient séparés depuis peu après un parcours conjugal jalonné de violences de l’homme sur sa femme. Quelques semaines avant le meurtre, la femme avait déposé une demande de protection d’urgence car son ex-mari l’avait agressée et elle craignait autant pour elle que pour l’enfant. Le tribunal avait cependant rejeté sa demande : la violence « domestique » n’apparaissait pas comme assez grave et, plus que tout, la procédure aurait eu pour effet d’empêcher Kevin de voir son fils. Or, c’était exactement ce que la mère demandait mais le magistrat trouvait cela inacceptable. Le fait qu’il y ait eu conflit pour l’attribution de la garde de l’enfant constitua un argument supplémentaire pour que la mesure de protection ne lui soit pas accordée. D’après le juge responsable de cette décision, une telle procédure pouvait « briser une famille » (extrait d’un article de presse de Van Derbeken, 2003).
Ici, deux observations : ce qui briserait une famille, c’est une mesure de protection de la mère et de l’enfant, ce n’est pas la violence du père ; le risque de briser une famille est considéré comme plus grave que le meurtre éventuel d’une femme ou d’un enfant. Dans d’autres cas, le tribunal a forcé des femmes qui avaient changé de ville et s’étaient réfugiées dans un lieu tenu secret à quitter le nouveau domicile ou à faire connaître cette nouvelle adresse afin de faciliter les contacts père-enfants ; d’autres juges ont considéré les inquiétudes maternelles comme une forme d’abus psychologique envers les enfants (Radford & Hester, 2006 ; Rhoades, 2002).
Les femmes en arrivent ainsi à se trouver contraintes à une situation impossible. Pas crues quand elles dénoncent les violences post-séparation1, leurs peurs raisonnables sont considérées comme exagérées ; leur opposition aux contacts entre le père et les enfants est vue comme une manifestation d’hostilité envers lui ou comme une vengeance. Par conséquent, il arrive que des mères soient punies – par des amendes, la prison ou la perte de la garde – pour avoir essayé de se protéger et de protéger les enfants. C’est ce que Radford et Hester (2006) décrivent, à partir de la Grande-Bretagne, comme « La vie sur les trois planètes » : des planètes avec des histoires et des logiques différentes et qui ne communiquent pas entre elles. Sur la Planète A, la violence conjugale est considérée comme un crime « sexué » (gendered) de l’homme sur la femme et la police et le tribunal peuvent intervenir pour protéger cette dernière (arrestation de l’homme ou ordre de protection). La Planète B correspond aux Services de protection de l’enfant, dont l’approche est « gender neutral ». Sur cette planète, on parle de familles abusives plus que de violences conjugales. C’est à la mère qu’il revient de protéger les enfants en s’éloignant de l’homme violent : si elle ne le fait pas, elle manque à son devoir de protection (failure to protect) et par conséquent elle peut perdre la garde des enfants. Mais si elle se sépare, elle finit dans l’orbite de la Planète C, à savoir les services chargés d’assurer les contacts entre père et enfants après la séparation qui sont motivés par le principe de la « responsabilité parentale » et par le souci de ne pas priver les pères de leurs droits. Sur cette Planète, la femme peut être contrainte à consentir aux visites entre les enfants et ce même père violent, sous peine d’être punie par une perte de la garde des enfants. Sur la Planète C, la violence de l’homme est ignorée tant que c’est possible à la faveur d’un discours selon lequel il n’y a pas de contradiction entre le fait d’être un ex-conjoint violent et un bon père ou, du moins, un père « suffisamment bon » (Radford & Hester, 2006, p. 791). De surcroît, il semble pris pour acquis que, pour le bien de l’enfant – son développement, sa sérénité, son bonheur – il soit préférable d’avoir des contacts avec un père violent que de ne pas en avoir du tout. Cependant, il n’y a aucune preuve scientifique de ce théorème (Eriksson et al., 2005 ; Jaffee, Moffitt, Caspi, & Taylor, 2003). Au contraire, toutes les études soulignent les effets négatifs, voire désastreux, d’être en contact avec un homme violent : les enfants présentent des problèmes de comportement et de santé mentale et apprennent des modèles d’interaction violente ce qui, surtout pour les petits garçons, augmente la probabilité que, devenus adolescents et adultes, ils soient violents avec leur compagne (Kitzmann, Gaylord, Holt, & Kenny, 2003 ; Jaffee et al., 2003).
Il est clair que, dans ce contexte complexe, quand il y a conflit pour la garde des enfants, il ne s’agit pas seulement d’un homme et d’une femme qui s’affrontent, chacun et chacune avec son histoire et ses motivations. Des idéologies et des valeurs s’affrontent aussi. L’idéologie qui ressort le plus clairement est une idéologie d’origine patriarcale, qui reconnaît aux pères, comme cela était accepté et même inscrit dans les lois il y a deux siècles, des droits sur les enfants, indépendamment de leurs comportements. La violence déjà manifestée par certains de ces pères à l’égard de leur femme et parfois même de leurs enfants ne semble pas constituer un obstacle insurmontable à ce que ces derniers leur soient confiés, avec souvent, comme nous l’avons vu, des conséquences tragiques.
1 46% des personnes interrogées dans une enquête nationale en Australie croient que les femmes séparées inventent les violences conjugales pour se venger de l’ex-conjoint (Flood, 2010).
La négation des violences post-séparation
La psychiatre Judith Hermann (1992) a puissamment décrit le « système négationniste » mis en œuvre pour éviter de voir les violences sexuelles et devoir prendre une position en faveur des victimes. Albert Bandura (1999) a développé le concept de désengagement moral, rendu possible par différentes stratégies – telles que la culpabilisation des victimes, l’utilisation des euphémismes, la division et la dilution des responsabilités, la négligence ou la falsification des conséquences – qui sont activées dans le but de justifier l’inaction, jusqu’à la complicité, face à des injustices. Les situations décrites dans les paragraphes précédents montrent qu’il y a bien négation des violences conjugales et paternelles post-séparation. Ce déni se fait à l’aide de ces stratégies mais s’appuie aussi sur des « théories » ou plutôt sur des mythes puissants et très répandus.
Un de ces mythes concerne les « fausses plaintes d’abus sur les enfants en phase de séparation » où l’on affirme que, autour de la séparation du couple, il existerait un nombre élevé de plaintes pour violence du père envers les enfants, formulées par les mères, et que ces plaintes seraient presque toujours fausses, motivées par un désir de vengeance. Toutefois, les données disponibles contredisent cette thèse.
Aux États-Unis, Thoennes et Tjaden (1990) ont analysé 9000 cas de divorce dans lesquels il existait un conflit ayant trait à la garde des enfants. Dans moins de 2% des cas, un des parents avait porté plainte pour violence sexuelle. Parmi ces plaintes, la moitié était fondée; un tiers était peu probable, dans les autres cas, il n’y avait pas assez d’informations pour trancher. Certains critères retenus pour décider du « peu de probabilité d’un cas » sont cependant discutables : l’enfant était très jeune, il n’y avait eu qu’un seul épisode de violence ou il y avait un conflit grave entre les parents. Au Canada, Trocmé et Bala (2005) ont analysé 7672 cas de maltraitance sur enfants signalés aux services sociaux : dans 4% de ces cas seulement, les dénonciations étaient fausses. En cas de conflits pour la garde des enfants après une séparation, cette proportion apparaissait plus élevée (12%) ; les fausses dénonciations concernaient plutôt la négligence que la violence sexuelle. De plus, les fausses dénonciations étaient formulées le plus souvent par le parent n’ayant pas la garde, en général le père (15%), que par l’autre parent, en général la mère (2%). Sur 7672 cas de maltraitance, il y avait seulement 2 fausses dénonciations contre un père n’ayant pas la garde. D’après des recherches en Australie, dans les causes relatives au « child contact », des plaintes pour violences sur les enfants étaient présentes entre 1% et 7% des cas ; seulement une minorité s’avérait fausse ; les plaintes déposées par les mères apparaissaient fondées quatre fois plus souvent que celles déposées par les pères.
Cependant, même quand les plaintes des mères étaient fondées et que les enfants manifestaient clairement leur refus de voir le père, les juges, dans la plupart des cas, accordaient aux pères des droits de visite, parfois sans aucune supervision (Flood, 2010).
En bref, les dénonciations de violences sur les enfants faites lors de la séparation ne sont pas fréquentes et elles sont très rarement fausses, surtout quand elles sont faites par les mères. Cependant, le préjugé selon lequel ces plaintes seraient des inventions de mères hostiles et vindicatives semble être à la base de nombreuses décisions des services sociaux et judiciaires. Quelques-unes de ces situations ont été documentées en France par une étude du Collectif Féministe Contre le Viol (1999), réalisée en collaboration avec la Délégation Régionale aux droits des femmes d’Ile de France. En deux ans et demi, 67 cas d’inceste dans un contexte de séparation des parents ont été constatés avec au total 94 mineurs impliqués, surtout des petites filles, qui accusaient dans la majeure partie des cas leur père. Dans 77% des cas, les enfants avaient clairement décrit les agressions subies, souvent très graves, et donné le nom de leur agresseur. En 1999, quand le rapport a été rédigé, 51 plaintes avaient été déposées. Néanmoins, dans plus de la moitié des cas, les plaintes avaient été classées sans même une enquête préliminaire ; dans 22% des cas, la mère, ne pouvant obtenir aucune information, ignorait ce qui se passait ; 9% des cas s’étaient conclus par un non-lieu ; un seul agresseur avait été condamné ; dans d’autres cas, l’enquête ou le procès était encore en cours. Souvent les mères étaient accusées de manipuler les enfants et étaient qualifiées par les experts de « névrosées, hystériques, vindicatives ». En outre, dans 20% des cas, les mères, parent protecteur, avaient été dénoncées à leur tour pour ne pas avoir voulu confier l’enfant au père lors de la visite décidée par le juge et un tiers d’entre elles avait été condamné. Ces cas dramatiques ont attiré l’attention de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, qui a envoyé en France un « spécial rapporteur », Juan Miguel Petit. Dans son rapport, Petit (2004) admet qu’en France, les personnes qui soupçonnent ou dénoncent des violences sur mineurs, surtout s’il s’agit des mères, se retrouvent face à d’énormes difficultés et risquent à leur tour d’être accusées de mentir ou de manipuler les enfants. Il évoque en outre le cas des mères divorcées préférant fuir et quitter leur pays plutôt que de confier leurs enfants aux maris suspectés de violence. À propos des accusations d’agression sexuelle de la part du père, qui apparaissent moins crédibles si elles naissent dans un contexte de procédure de divorce, il affirme qu’« un examen attentif des raisons pour lesquelles les parents étaient en train de divorcer a révélé un pattern de violence domestique en famille, y compris la violence domestique exercée contre la mère » (p. 14). Il conclut que « de nombreux individus occupant des positions de responsabilité dans le domaine de la protection des enfants, plus particulièrement dans la magistrature, refusent encore de reconnaître l’existence et l’ampleur de ce phénomène, incapables d’accepter le fait que beaucoup de ces accusations de violence sexuelle puissent être vraies » (p. 20).
Un autre outil puissant dans le déni des violences du père envers les enfants après la séparation est constitué par le Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP) (Romito & Crisma, 2009). Lorsqu’un enfant refuse de rencontrer le parent auquel il n’a pas été confié – généralement le père – en disant qu’il en a peur et qu’il est soutenu par sa mère, on évoque alors le SAP : l’enfant refuserait de voir son père non pas parce qu’il le craint, mais parce que sa mère l’aurait manipulé dans ce sens. Le SAP est ainsi présenté comme s’il s’agissait d’une catégorie psychiatrique objective, d’un diagnostic scientifique. La conséquence de ce « diagnostic » est que les peurs de l’enfant et la possibilité de violences envers lui sont sous-évaluées ; qui plus est, les mères deviennent les coupables puisqu’elles ont fait subir aux enfants « un lavage de cerveau » en induisant un syndrome psychiatrique et en les détournant de leur père.
Le SAP a été formulé en 1985 par R. Gardner, un psychiatre états-unien, à partir de l’observation d’un nombre non précisé de cas suivis par lui-même dans sa pratique d’expert devant les tribunaux, généralement du côté de la défense de pères accusés d’inceste. Le SAP a suscité de multiples controverses entre les experts des domaines judiciaire, social et de la santé mentale1. La confusion conceptuelle qui entoure le concept de l’aliénation parentale, la quasi absence de soutien empirique à un tel syndrome, de même que les problèmes de fidélité et de validité liées à son diagnostic, amènent plusieurs auteurs à douter de sa validité clinique, voire de son existence (Gagné, Drapeau, & Hénault, 2005). Les psychiatres experts pour le DSM (Manuel Statistique et Diagnostic des maladies mentales utilisé à échelle mondiale) ont refusé de l’y inclure.
L’American Psychological Association (APA) a exhorté les psychologues à être très attentifs face aux cas de violence et à ne pas sous-évaluer les déclarations des enfants (APA, 1996). L’Association Espagnole de Neuropsychiatrie considère le SAP comme une invention et s’est déclarée contre son utilisation dans des contextes cliniques ou judiciaires (2010)2.
Malgré les critiques et les prises de position très claires, le SAP reste toutefois utilisé dans les services sociaux et dans les tribunaux de nombreux pays3.
Dans un paragraphe sur l’occultation des violences conjugales post-séparation, ne peut manquer une mention à la médiation familiale. Non que la médiation soit un outil controversé comme le SAP : il s’agit d’une pratique et d’une profession qui ont leur place dans la gestion des conflits sociaux. Cependant, la médiation peut participer à l’occultation des violences, déjà par ses principes théoriques : en s’inspirant d’un modèle systémique, elle se base sur des notions de circularité des processus, de responsabilité partagée et de neutralité thérapeutique et donc se prête mal à « gérer » des situations de violence (Cresson, 2002). En outre, la pratique de la médiation requiert de la part des deux conjoints qu’ils se concentrent sur le présent et le futur sans vouloir revenir sur le passé et les conflits qui lui sont liés ; le dépôt de plaintes éventuelles ou toute autre démarche judiciaire doit être suspendu. Dans ce contexte, si la femme soulève la question des violences, en faisant valoir par exemple que rencontrer l’ex-mari pour lui confier les enfants la placera dans une situation dangereuse ou bien en exprimant sa crainte qu’il les néglige ou les maltraite, elle enfreint les règles du jeu et risque d’être jugée comme vindicative et rancunière (Radford & Hester, 2006), la même accusation que dans le « SAP » et dans les « fausses dénonciations d’agressions sexuelles incestueuses » dans un contexte de séparation.
Selon de nombreux auteurs, la médiation familiale ne devrait pas être préconisée en cas de violence conjugale (Biletta & Mariller, 1997 ; Kurki-Suonio, 2000 ; Smart & Sevenhuijsen, 1989), un avis réitéré par la députée Marianne Eriksson (1997) dans un rapport au parlement européen. Selon les principes déontologiques établis en France par le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale, la médiation se définit par son caractère volontaire. La garantie de consentement signifie pour les médiateurs-trices « être particulièrement attentifs aux situations d’emprise et violences conjugales ou familiales susceptibles d’altérer le consentement de l’une ou l’autre partie ». Mais, en même temps, l’un des objectifs généraux de la médiation familiale est de favoriser l’exercice commun de l’autorité parentale et « l’affirmation durable des parents quelle que soit l’histoire de leur couple ». Or, il y a une contradiction potentielle entre les deux objectifs énoncés, la médiation pouvant être utilisée même en situation de violence (CNCMF, 2004, cité par Casas Vila, 2009). En fait, il semble bien que, malgré les avis contraires, la médiation soit précisément proposée ou imposée quand il y a eu des conflits majeurs assortis de violences. En dépit des risques connus, les femmes sont souvent soumises à de fortes pressions pour accepter la médiation plutôt que d’entreprendre une procédure judiciaire (Eriksson et al., 2005 ; Kurki-Suonio, 2000 ; Rhodes, 2002). Une étude en Californie a montré que dans plus des deux tiers des cas de médiation familiale imposée par les tribunaux, il y avait des précédents de violence conjugale.
Dans 60% de ces cas, il avait même été difficile de garantir la sécurité des femmes, au point que certaines ont été tuées par leur ex-partenaire alors qu’elles se rendaient à ces rendez-vous de médiation (Beck & Sales, 2001). Au Japon, où cette pratique est obligatoire si un des conjoints ne consent pas au divorce, plus d’un tiers des cas de médiation familiale concerne des situations avérées de maris violents (Yoshihama, 2002). Il est donc probable que, là encore, la médiation familiale soit pratiquée dans les cas où il faudrait qu’elle soit évitée.
Alors que les risques entraînés par cette pratique en cas de violences conjugales sont évidents, les avantages de la médiation par rapport au recours juridique (avocats, procès, etc.) n’ont jamais été démontrés (Beck & Sales, 2001). Les résultats d’une analyse effectuée par l’American Psychological Association, montrent que, à moyen ou long terme, les rapports entre ex-conjoints ayant entrepris une médiation ne sont pas moins conflictuels que les autres, les accords concernant les enfants ne sont pas mieux respectés et c’est dans les mêmes proportions que les divorcés recomparaissent au tribunal pour que soient modifiés les accords précédents (Beck & Sales, 2001).
Bref, il paraît que le principal avantage de la médiation familiale, qui fait que l’on prend le risque de l’utiliser même dans des cas de violences conjugales avérées, soit sa cohérence avec le modèle du « bon divorce » dans lequel les conjoints placent au second plan leurs différends « pour le bien de l’enfant » ; le bien en question, on l’entend a priori comme devant être associé à la conservation d’un rapport entre les deux parents, le plus souvent sous la forme de la garde conjointe ou de coparentalité. Ce principe idéologique prévaut sur une analyse objective des risques et des bénéfices (Cresson, 2002). À cet effet, Donald Saposnek, pionnier de la médiation familiale et directeur du Family Mediation Service de Santa Cruz en Californie où, depuis 1981, la médiation est imposée par le tribunal en cas de conflits au sujet des enfants, a reconnu que souvent ce procédé peut pénaliser les femmes et mettre en péril le bien-être des enfants (Saposnek, 1998).
1 Pour une discussion, voir Gagné, Drapeau et Hénault (2005) ; Myers, 1997 ; Romito, 2006 ; Romito & Crisma, 2009.
2 http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf, consulté en septembre 2010. La revue internationale de l’éducation familiale, n°29, 2011
3 En Italie, une proposition de loi est en discussion, dans laquelle l’on affirme que « la littérature scientifique a désormais montré l’existence de ce syndrome ainsi que son remède principal, le fait de priver le parent « aliénant » de sa puissance parentale » (traduction de l’auteure). Il s’agit d’une loi soutenue par des Associations de pères séparés http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00326101.pdf, consulté en septembre 2010.
Conclusion
La violence conjugale post-séparation est fréquente, souvent très grave, et représente un obstacle majeur à ce que les femmes et les enfants qui ont subi des violences puissent retrouver leur sérénité et s’engager activement vers une nouvelle vie. Malheureusement, cette violence reste en grande partie occultée, notamment par le refus de la part d’institutions comme les services sociaux et de santé, les magistrats et les media d’accepter de la voir. Par conséquent, femmes et enfants se trouvent parfois démunis sans aide et sans soutien. Selon le théologien Michael Downd : « Imaginer la vie quotidienne d’une femme battue par son partenaire dépasse l’entendement de l’individu moyen et […] l’attitude qui consiste à nier l’histoire de cette femme peut être plus commode que celle de la regarder en face» (Dowd, in Romito, 2006, p. 199). Tant que cette attitude ne sera pas reconnue, mise en discussion et rejetée, le bien-être et même la survie des victimes de ces violences ne pourront pas être assurés. »

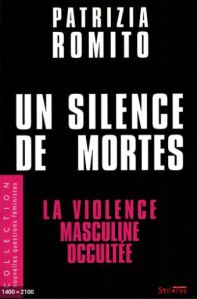
Ping : Silencier les femmes victimes en prétendant qu’elles « se victimisent » (procédé anti-victimaire) – Marianne Kuhni
Ping : La violence machiste systémique et la non-reconnaissance des femmes victimes – Marianne Kuhni
Ping : Domination masculine et appropriation du ventre des femmes – Marianne Kuhni
Ping : La colonisation par l’agresseur et l’excitation traumatique – Marianne Kuhni